François-Marie GERARD
|
Références : GERARD, F.-M. (2015). Le néolibéralisme se niche-t-il au sein même des dispositifs pédagogiques scolaires ?, in S. VARIN & J.-L. CHANCEREL (dir.). Néolibéralisme et éducation - Éclairages de diverses disciplines, Louvain-la-Neuve : Academia L'Harmattan, pp. 135-154. Téléchargez
ici l'article en format |
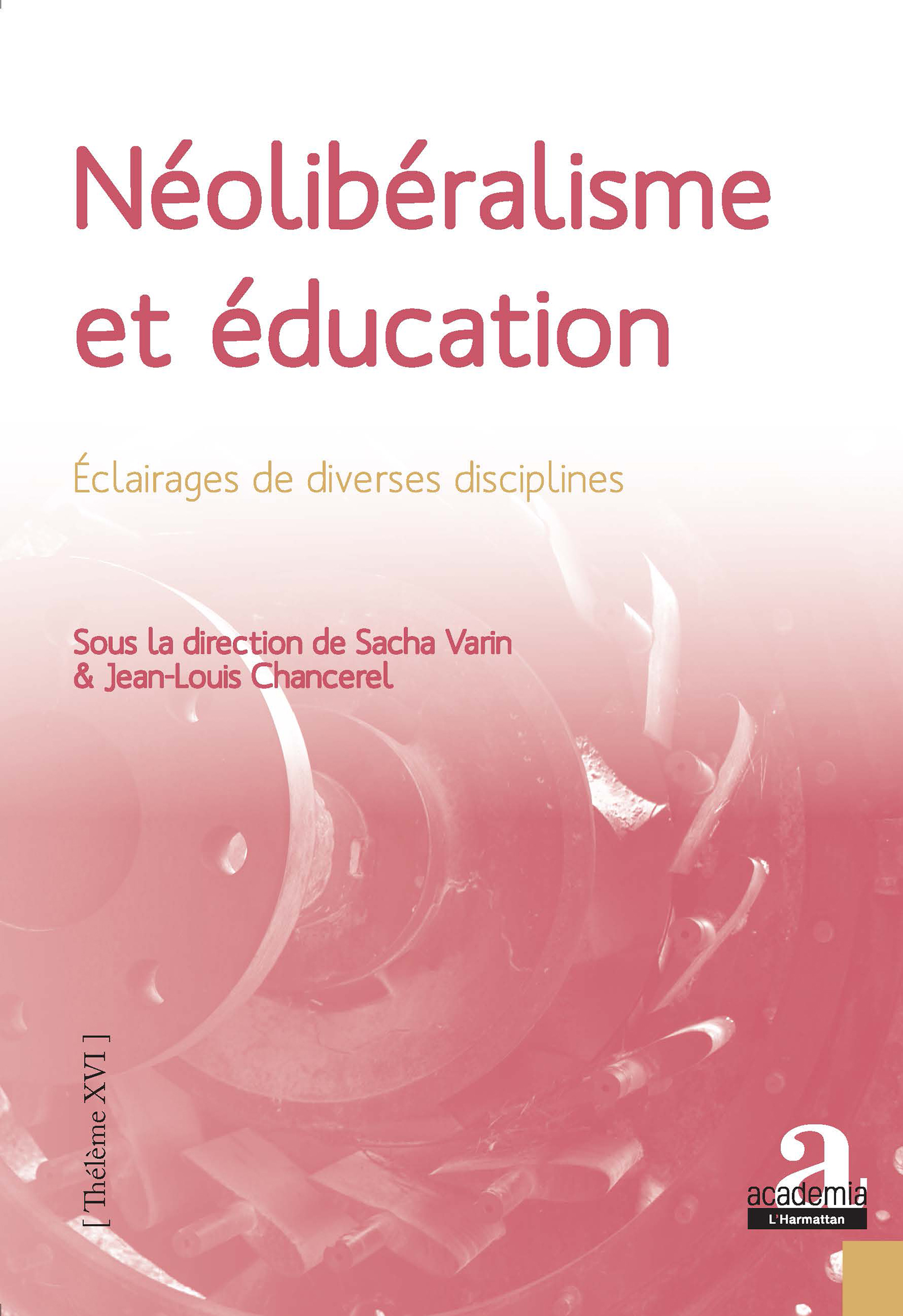 Abstract
Abstract
L’école est une réalité complexe qui ne peut être réduite à des mécanismes caricaturaux. Néanmoins, il est opportun de se demander dans quelle mesure les dispositifs pédagogiques, propres à l’école, ne sont pas des outils servant ou non la cause diffuse du néolibéralisme. La réflexion menée ici concerne trois types de dispositifs scolaires : d’une part ceux qui sont en amont du travail dans les classes, c’est-à-dire la définition des curriculums ou des attendus de l’enseignement, notamment en termes de compétences, et d’autre part ceux qui fonctionnent en aval du travail dans les classes, autour de l’évaluation, notamment à travers les évaluations internationales telles que les enquêtes PISA. Cette réflexion est complétée par un regard – forcément incomplet – sur les pratiques en œuvre dans les classes.
1. Introduction
L’école est un système complexe, composé d’un grand nombre d’entités – elles-mêmes complexes – en interaction constante, ni stabilisée, ni standardisée. Il n’est pas possible de réduire l’école à une équation qui intégrerait toutes ces entités et toutes les interactions qui les animent pour permettre de dégager un « déterminisme scolaire » susceptible d’expliquer tout ce qui se passe et surtout d’isoler l’un ou l’autre élément sur lesquels on pourrait agir de manière suffisamment consciente et volontaire pour améliorer son fonctionnement et sa qualité.
C’est d’autant plus le cas que de nombreuses entités et/ou interactions sont en quelque sorte extérieures à l’école, liées à la société, aux politiques, à l’histoire, à l’économie… Lorsqu’on veut porter un regard sur l’école, on ne peut faire abstraction de tous ces éléments extérieurs. Cela est particulièrement vrai lorsqu’on analyse l’influence du néolibéralisme sur l’école. À ce stade, nous considérons que ce terme plutôt vague – et nous espérons que l’ensemble des contributions de cet ouvrage aidera à l’affiner - désigne (note 1 ) tout à la fois une idéologie, une vision du monde, des modes de gouvernement, des théories marquant un renouveau et une radicalisation du libéralisme. Cette mouvance, qui nourrit les systèmes sociétaux de la fin du 20e et du début du 21e siècles, se caractérise notamment
- par la limitation du rôle de l'État à ses fonctions régaliennes (garantir les libertés individuelles et la sécurité des citoyens), sans intervention dans la vie économique, sociale et juridique ;
- par l'ouverture de nouveaux domaines d'activité à la loi du marché (privatisation des services tels que la poste, les transports en commun, voire l’école…) ;
- par une vision de l'individu en tant qu'« entrepreneur de lui-même » ou en tant que « capital humain » que celui-ci parviendra à développer et à faire fructifier s'il sait s'adapter, innover…
La notion de « capital humain » - introduite en 1961 par l’économiste américain Theodore Schultz et développée ensuite par Gary Becker (1964) – n’est pas en soi spécifique au néolibéralisme. Néanmoins, selon Schultz, il existe un lien entre la qualité du capital humain – niveaux d’éducation et de santé – et la croissance économique. Pour lui et d’autres économistes, dans une économie moderne, la croissance repose sur l’existence d’une population active ayant un bon niveau d’éducation. La tendance sera dès lors, notamment à travers les « Plans d’Ajustement Structurel » (PAS) imposés par le FMI et la Banque mondiale aux pays du Sud (Houtart 1994) ou encore dans les travaux de l’OCDE (Keeley 2007), de favoriser et de contrôler le développement de ce capital humain, dans une perspective à la fois d’uniformisation (il faut que les savoirs et les compétences soient plus ou moins identiques pour tout le monde) et d’utilitarisme (il faut que ces savoirs et ces compétences servent la croissance économique).
On voit combien cette vision peut à différents niveaux influencer l’école, de manière externe. Mais à côté de ces influences extérieures, il est également opportun de se demander dans quelle mesure les dispositifs pédagogiques, propres à l’école, ne sont pas eux-mêmes des outils servant ou non cette cause diffuse du néolibéralisme. La réflexion menée ici concerne trois types de dispositifs scolaires : d’une part ceux qui sont en amont du travail dans les classes, c’est-à-dire la définition des curriculums ou des attendus de l’enseignement, et d’autre part ceux qui fonctionnent en aval du travail dans les classes, autour de l’évaluation. Cette réflexion est complétée par un regard – forcément incomplet – sur les pratiques en œuvre dans les classes.
2. En amont : les compétences
Dans l’arsenal pédagogique, on a vu ces dernières années émerger, pour ne pas dire s’imposer, la notion de compétence. Cette apparition ne se fit pas sans de nombreux débats, y compris conceptuels tant il est vrai qu’il s’agissait d’un « concept faible » en ce sens que tous les utilisateurs du concept de compétence ne le reliaient pas nécessairement aux mêmes éléments, aux mêmes démarches, aux mêmes origines… Ainsi, pour certains, notamment Tilman (2008), la compétence est directement issue du monde de l’entreprise, dans la lignée des travaux sur l’ergonomie et la sociologie du travail des années 1980 et 1990, avec la nécessité de disposer de travailleurs qui puissent s’adapter en permanence à du matériel et à une organisation en constante évolution. Une telle exigence conduit à ne plus considérer un travailleur à travers les seuls gestes professionnels qu’il accomplit sur son poste de travail, mais à attendre de lui des comportements plus adaptatifs, plus souples, plus intégrés, ce que recouvre bien la notion de compétence. On ne peut donc nier que celle-ci occupe une place de choix dans la dynamique et le développement des entreprises. Cela ne signifie pas pour autant que ce soit l’entreprise qui ait exporté cette notion dans le monde scolaire. Plus vraisemblablement, elle s’y est développée de manière autonome et parallèle, tout en reposant sur les mêmes constats et les mêmes nécessités de pouvoir s’adapter à un univers mouvant et gérer les situations complexes qu’il génère. Historiquement, il semble d’ailleurs que la notion de compétence soit d’abord apparue dans le monde de l’enseignement (Block 1978 ; Cardinet 1982 ; Spady 1977 ; cités dans Bosman, Gerard & Roegiers 2000).
Quelle que soit l’origine du concept, il a conduit à des dynamiques et des changements importants dans les systèmes éducatifs engagés dans « l’approche par les compétences » (APC) en se fondant sur des idées fortes, aujourd’hui partagées par quasi tous les partisans de cette approche (Roegiers 2008) :
- apprendre ne se limite pas à acquérir des savoirs et des savoir-faire, mais aussi à développer des savoir-être permettant d’agir de manière responsable et citoyenne ;
- apprendre ne peut se faire de manière passive ; l’activité de l’élève est au centre de son apprentissage ;
- apprendre nécessite d’être confronté à des situations complexes.
À la suite de Roegiers (2008), nous pensons qu’au-delà de ces idées-forces communes, l’appellation « approche par les compétences » est un leurre, qui semble faire croire qu’il n’y a qu’une seule et unique manière d’opérationnaliser et de faire entrer dans les pratiques pédagogiques la notion polysémique de compétence. Il est plus approprié de parler « d’approches par les compétences », avec des postures différentes dans le système complexe qu’est l’école où elles s’insèrent.
Roegiers (2008) distingue ainsi cinq « approches par les compétences » différentes qui existent toutes – à des degrés divers et de manière non exclusive – dans les systèmes éducatifs qui se réfèrent aux compétences.
- Les « standards » définissent – de manière normative – les connaissances, les habiletés et les attitudes qui devraient être maîtrisées par toute personne à un certain niveau de formation, notamment dans le cadre d’une reconnaissance des acquis. Ces « standards », surtout utilisés dans le monde anglo-saxon, sont dans la droite ligne de la pédagogie par objectifs et de la pédagogie de la maîtrise (Bosman, Gerard & Roegiers 2000 ; Chancerel 2013). L’accent est mis sur l’apprentissage et l’évaluation de savoir-faire ou des skills minimaux correspondant à chaque niveau. La perspective est fortement liée aux activités professionnelles, dans une optique d’employabilité. Roegiers relie cette approche – de manière nuancée – au « Cadre européen des certifications » (CEC), auquel on peut rattacher les learning outcomes ou acquis d’apprentissage, très prégnants notamment dans le cadre de l’« espace européen de l’enseignement supérieur » (EEES).
- Les « compétences de base » concernent le bagage cognitif, gestuel et affectif qui permet à un individu d’agir concrètement dans des situations complexes, en tant que citoyen responsable. L’apprentissage n’est pas uniquement concentré sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être indispensables, mais aussi sur leur intégration dans une démarche plus globale afin d’agir de manière consciente et critique dans le cadre de situations concrètes et complexes (De Ketele 1996 ; Gerard & BIEF 2008 ; Roegiers 2000, 2010). L’approche est donc fortement contextualisée et vise non seulement l’insertion et l’adaptation dans un tissu socio-économico-culturel en évolution constante, mais aussi la co-construction de cet environnement par les individus.
- Les « compétences de vie », ou life skills, représentent essentiellement les valeurs citoyennes universelles telles que la coopération, la tolérance, la prise de décision responsable, le respect de l’environnement, la préservation de la santé, etc. L’accent est mis plus sur les attitudes ou les savoir-être que sur les savoirs et les savoir-faire. La perspective est liée à la mondialisation de l’éducation, en attribuant à l’école un rôle fondamental dans la socialisation des élèves, en fonction du modèle dominant : s’il y a ouverture vers la citoyenneté, celle-ci est plus orientée vers une uniformisation des comportements.
- Les « compétences transversales » mettent l’accent sur les capacités mobilisées dans les différentes disciplines, de manière transversale : chercher l’information, la traiter, communiquer, etc. La perspective est donc de développer un ensemble de « savoir-faire génériques » (generic skills) ou de « compétences-clés » (key competencies), afin que les individus disposent du bagage intellectuel nécessaire à leur mobilité et à leur adaptation à un environnement changeant.
- Une cinquième conception de l’approche par les compétences est, selon Roegiers, moins liée aux objectifs poursuivis qu’aux pratiques pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du courant socioconstructiviste. C’est en étant confrontés à des situations réelles complexes que les élèves vont construire leurs compétences directement liées à ces situations. Selon Jonnaert (2002), l’approche par compétences s’inscrit nécessairement dans le paradigme socioconstructiviste, à l’exclusion de tout autre paradigme, notamment les pratiques issues de la pédagogie (néo-béhavioriste) par objectifs.
Ces différentes conceptions de l’approche par les compétences sont opérationnalisées de manière plus ou moins différenciée dans les systèmes éducatifs qui se réfèrent aujourd’hui – de manière explicite, mais aussi parfois implicite – aux compétences. Les différentes conceptions peuvent d’ailleurs très bien coexister dans un même système éducatif, y compris dans les référentiels officiels. Par exemple, en Communauté française de Belgique, les « Socles de compétences », communs à toutes les écoles fondamentales et secondaires(note 2 ), mais opérationnalisés par différents programmes spécifiques à chaque « réseau », constituent une sorte de « fourre-tout » dans lequel les partisans de l’une ou l’autre conception peuvent y trouver ce qu’ils espèrent.
Cependant, chacune de ces conceptions n’a pas le même statut par rapport à l’influence que pourrait avoir le néolibéralisme sur l’éducation. Le présent ouvrage montre combien il est difficile de cerner avec précision non seulement ce qu’est le néolibéralisme, mais aussi et a fortiori en quoi il peut avoir une influence sur les systèmes éducatifs. Selon Laval (2007), les recherches en ce domaine ont exploré plusieurs directions, dont notamment le fait que les politiques d’éducation se dessinent désormais à l’échelle mondiale, avec un axe normatif commun, utilitariste et individualiste, articulé de diverses manières à la logique du marché et au modèle de l’entreprise. Dans cette perspective, le savoir n’a de valeur que dans ses dimensions utilitaristes : « la connaissance ne vaut que par son utilité économique, la formation n’a de valeur et de légitimité que par l’emploi qu’elle permet d’occuper » (p. 4). À cet égard, les différentes conceptions de l’approche par les compétences n’occupent pas la même posture. Les approches par les « standards » et par les « compétences de vie » sont celles qui s’inscrivent le plus dans une uniformisation des attendus scolaires, les « standards », fortement orientés vers l’employabilité, mettant particulièrement en avant la dimension utilitariste des savoirs.
Sur un autre plan, les travaux de Bernstein (1977, 1990(note 3 )), cités par Letor et Mangez (2008), ont mis en avant la question des « pédagogies invisibles » dans lesquelles l’accent n’est plus mis sur la transmission des savoirs, mais sur le développement et l’épanouissement de l’enfant, l’apprentissage étant conçu comme un processus tacite, proprement invisible. Selon Letor et Mangez, si le débat autour des pédagogies invisibles n’est pas clos, il semble que le recours à ces pédagogies soit plus créateur d’inéquité que d’équité entre les apprenants. À nouveau, les différentes conceptions de l’approche par les compétences n’ont pas le même statut en termes de « visibilité » : les approches par les « compétences transversales » et celles ancrées dans le courant socioconstructiviste se caractérisent par une moindre visibilité que les autres.
Affirmer que l’approche par les compétences s’inscrit dans une dynamique néolibérale serait un propos réducteur. Si une approche curriculaire basée sur le développement de compétences – surtout lorsqu’elles s’inscrivent dans la droite ligne du statut qui leur a été donné au sein des entreprises – peut d’une part effectivement, en promouvant l’uniformisation des attendus dans une perspective utilitariste, contribuer – selon l’expression de Laval (2007) – au « nouvel ordre mondial de l’éducation », si le développement des compétences s’inscrit d’autre part parfois dans des pédagogies invisibles inéquitables, elles peuvent aussi contribuer à développer des citoyens responsables et critiques, à même d’affronter des situations complexes et de leur apporter – en mobilisant leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être – des solutions concrètes, originales et durables.
3. En aval : l’évaluation
L’influence néolibérale au sein même du système éducatif ne se réalise pas seulement au travers d’outils aussi fondamentaux que les curriculums, par la définition des attendus en termes de compétences, mais aussi par l’intermédiaire des processus d’évaluation des acquis des élèves et des performances du système.
À cet égard, les évaluations mises en œuvre au travers des épreuves internationales (TIMSS(note 4 ), PISA(note 5 ), PIRLS, MLA…) ont une double « vertu » : d’un point de vue passif, elles permettent une comparaison des performances des systèmes éducatifs, puisque ces épreuves débouchent sur un classement, mais, d’un point de vue plus actif, elles constituent aussi une occasion de situer un système éducatif par rapport aux autres, et d’y apporter des régulations. Ces épreuves posent cependant plusieurs questions, dont la moindre n’est pas de savoir ce qu’on évalue et ce qu’on n’évalue pas (De Ketele 2010). Ainsi, ces évaluations ne s’intéressent pas à des compétences aussi fondamentales que la communication orale, la production écrite ou des « compétences de vie » (Gerard & Roegiers 2011). Elles poursuivent cependant l’objectif d’évaluer certaines compétences, notamment en mathématiques, en proposant certaines situations complexes présentées dans un contexte concret. Si les résultats à ces items montrent la difficulté qu’ils représentent pour certains élèves, par exemple en France, il existe cependant un problème de validité à leur égard. Les concepteurs déclarent vouloir évaluer des « compétences » à travers des situations complexes, mais ils décomposent tellement la tâche en sous-tâches (afin d’assurer une standardisation des réponses) que celles-ci n’évaluent plus que des « ressources » en termes de restitution ou d’application, ce qui reflète la difficulté réelle d’une évaluation standardisée en termes de compétences (De Ketele & Gerard 2005).
De plus, ces épreuves se fondent sur l’idée d’un « élève idéal standard », sans prendre en compte des réalités locales, régionales ou nationales, notamment à travers différentes cultures linguistiques, alors que celles-ci expliquent une bonne part de la variance, comme le montrent par exemple les études réalisées autour du concordat HarmoS(note 6 ), en Suisse (Behrens 2009). Cet auteur pose ainsi une question fondamentale : « peut-on contrôler une acquisition particulière indépendamment d’un contexte d’apprentissage ? » (p. 3). L’idée même qu’il puisse exister un « élève idéal standard » évaluable correspond ainsi à une perspective d’uniformisation qui sous-tend les pratiques pédagogiques inspirées du néolibéralisme.
Malgré les critiques que l’on peut adresser à ces épreuves internationales, force est de constater qu’elles représentent aujourd’hui un repère majeur dans l’évolution des systèmes éducatifs, qui conduit ces derniers à renforcer leurs dispositifs d’évaluation externes des acquis des élèves, comme c’est le cas par exemple en Belgique francophone, non sans contradiction. Ainsi, si le système éducatif de la Communauté française de Belgique s’est clairement prononcé pour une approche par les compétences, on constate que la première épreuve externe d’évaluation certificative qui est devenue obligatoire(note 7 ) (le CEB, à la fin de l’enseignement fondamental) – rompant ainsi avec une longue tradition de responsabilisation des équipes éducatives locales – ne présente pas de situations complexes et n’évalue que des savoirs et des savoir-faire(note 8 ) (Carette & Dupriez 2009) alors même que la « Commission des outils d’évaluation » propose aux enseignants – à titre d’outils pédagogiques – des épreuves non étalonnées, mais basées sur la construction de tâches complexes et inédites (Gerard 2013).
Au-delà des limites internes de ces épreuves standardisées d’évaluation, il importe aussi de constater qu’elles ne permettent que de porter un regard limité sur la qualité des systèmes éducatifs. La dimension essentiellement mise en avant est l’efficacité de ces systèmes. Celle-ci n’est de plus perçue que comme une efficacité interne à court terme : un « bon » système éducatif serait celui dont les élèves, par exemple ceux de 15 ans dans le cas de PISA, ont acquis les savoirs et savoir-faire considérés comme étant le bagage pédagogique universel indispensable pour se retrouver dans la « vraie vie », ce qui à nouveau correspond bien à une perspective néolibérale d’uniformisation utilitariste.
L’impact de ces épreuves internationales sur les systèmes éducatifs est tel qu’on peut considérer qu’elles induisent que la qualité d’un système éducatif se réduit à cette efficacité interne à court terme, certes indispensable, mais non suffisante. Ce faisant, elles minimisent d’autres dimensions qui sont pourtant tout aussi fondamentales et qui, ensemble, devraient constituer l’objet des évaluations de la qualité d’un système éducatif ou de formation (Gerard 2001).
Sans entrer dans le détail de leur évaluation, notamment les indicateurs qui la permettent, on peut relever que les épreuves internationales ne prennent que peu en compte les dimensions suivantes :
- l’efficacité externe, qui concerne les produits ou effets engendrés par le système de formation observés hors de ce système lui-même. L’évaluation de l’efficacité externe revient à se demander si les bénéfices attendus à la suite de la formation, sont réalisés, non seulement eu égard à l’emploi, mais aussi en termes de citoyenneté responsable, d’épanouissement personnel, de communication sociale... L’efficacité externe est peu étudiée dans les enquêtes internationales, ce qui est relativement paradoxal dans la mesure où la question de l'employabilité est une des raisons principales de leur existence ;
- l’équité, qui est liée à la justice sociale : un système éducatif est d’autant plus équitable qu’il réduit les disparités entre les plus forts et les plus faibles, entre les groupes favorisés et défavorisés. En réalité, cette dimension est présente dans le dispositif d’évaluation PISA. Celui-ci a permis ainsi de mettre en évidence que les systèmes éducatifs de la France et de la Communauté française de Belgique sont particulièrement inéquitables, ce qui a entraîné des décisions politiques pour contrer ce phénomène, par exemple en favorisant la mixité sociale au sein des établissements. L’équité est donc une préoccupation importante pour les concepteurs des évaluations PISA, mais elle n’est cependant pas toujours mise suffisamment en évidence ;
- l’efficience, dont l’évaluation s’attarde sur la nature et le volume des moyens mis en œuvre pour exécuter le programme de formation et donc pour atteindre ses résultats. Il s’agit de mettre en relation les produits du système avec les ressources — qu’elles soient institutionnelles, humaines, matérielles, financières, spatiales, temporelles ou encore méthodologiques — qui ont été mises à sa disposition. Cette dimension, pourtant chère aux politiques néolibérales, est relativement peu étudiée par les évaluations internationales ;
- l’équilibre, qui porte sur la dimension pédagogique du système de formation. Celui-ci s’efforce de transmettre et de développer un certain « savoir » chez chaque individu, et il le fait de manière équilibrée lorsque toutes les dimensions de ce savoir sont effectivement promues auprès de l’apprenant, ce qui englobe, pour les systèmes éducatifs, les dimensions artistiques, culturelles, socioaffectives, psycho-sensori-motrices… ainsi que les valeurs ;
- l’engagement, qui est sans doute la qualité première et indispensable de tout système de formation, celle de donner aux apprenants – qu’ils soient élèves, étudiants, chômeurs, travailleurs… – l’envie d’apprendre et de provoquer l’engagement de ceux-ci dans une démarche d’apprentissage. Même dans les systèmes de formation professionnelle continue, cette dimension est aujourd’hui considérée comme essentielle (Kirkpatrick & Kayser Kirkpatrick 2009), alors qu’elle n’est que peu prise en compte dans les dispositifs et les indicateurs d’évaluation des systèmes éducatifs.
Sur la base de ces dimensions de la qualité d’un système éducatif peu ou pas prises en compte dans les évaluations internationales, on peut constater que celles-ci favorisent une certaine conception de cette qualité en la limitant à certaines caractéristiques qui s’inscrivent particulièrement bien dans une approche néolibérale de l’éducation attachée à une uniformisation utilitariste des objectifs et des profils recherchés.
4. Au cœur des pratiques pédagogiques
Il serait illusoire d’analyser toutes les pratiques pédagogiques vécues dans les classes et de vouloir les associer de près ou de loin à une perspective néolibérale. La réalité est de toute façon plus complexe que celle qu’on pourrait figer dans quelques poncifs bien poncés.
On peut néanmoins constater que l’école d’aujourd’hui est fortement influencée par une tendance à l’individualisation et à la consommation. Parmi les praticiens, une pensée fortement présente – même si elle n’est pas corroborée par la recherche en ce domaine (Crahay 1996 ; Kahn 2011) – semble stipuler que la réussite – ou l’échec – de l’élève est de sa propre responsabilité, dans la lignée des réflexions ultralibérales de Dalymple (2013). Selon cette pensée, si l’élève réussit, c’est parce qu’il produit l’investissement nécessaire et utilise efficacement les ressources qui sont mises à sa disposition. Si par contre l’élève a des difficultés et est en échec, c’est avant tout de sa faute, traduite souvent par les praticiens en fainéantise notoire. La responsabilité de l’école et des enseignants n’est que très rarement engagée. Les solutions sont donc la plupart du temps externalisées : si l’élève a des difficultés, il n’a qu’à faire appel à des cours particuliers ou à du coaching scolaire, contre monnaie sonnante et trébuchante. Même si la responsabilité des élèves ou des étudiants ne peut être niée, ils ne sont pas toujours perçus par l’institution éducative et ses acteurs comme des êtres en développement qu’il s’agit d’accompagner de manière responsable, mais souvent comme des clients qui n’ont qu’à payer s’il ne sont pas contents ou s’ils ne peuvent se contenter des services fournis par le système.
La première attente vis-à-vis de l’élève est souvent qu’il se soumette. L’élève rebelle, même s’il est simplement critique, ne trouve que rarement sa place dans les systèmes éducatifs d’aujourd’hui, surtout s’il provient d’un milieu défavorisé ou « étranger ».
Quand on y regarde de plus près, les méthodes pédagogiques les plus fréquentes s’appuient sur deux modèles, apparemment antagonistes, mais en réalité complices dans leur dimension implicite :
- un modèle transmissif où le cours magistral ou dialogué imprime une démarche déductive censée installer les savoirs visés de façon progressive et sans rencontrer d’obstacles. L’implicite repose ici d’une part sur l’idée qu’il suffit de « dire le savoir » à l’élève pour qu’il le comprenne et l’apprenne et d’autre part sur celle que forcément tous les élèves savent et comprennent de quoi il est question. Or, les codes des enfants des milieux populaires sont souvent trop éloignés de ceux de l’école (Bonnard 2013) ;
- un modèle (socio-)constructiviste où l’enseignant n’est qu’un facilitateur proposant des situations à partir desquelles les élèves construiront (ensemble) leurs savoirs et leurs compétences. L’implicite est fondé sur l’idée que tous les élèves ont envie d’apprendre et savent comment le faire. Or, si les enfants apprennent de nombreux savoirs de manière informelle dans la vie de tous les jours, ils sont souvent démunis – spécialement les enfants de milieux populaires – pour transformer cet apprentissage informel en apprentissage formel valorisable au sein de l’institution scolaire.
Ces deux modèles présentent des limites importantes : « recevoir » des savoirs n’est pas plus efficace que de les « construire ». Dans tous les cas, il s’agit aussi de s’approprier les savoirs, de leur donner sens, de les formaliser, de les structurer pour les rattacher dans une structure cognitive cohérente et significative (Ausubel 1968 ; Bissonnette et Richard 2001).
À cet égard, les pratiques pédagogiques les plus démocratiques ne sont pas toujours celles qu’on croit. Braibant et Gerard (1996) ont ainsi été les premiers, dans le monde francophone, à montrer, sur la base de données empiriques, que les résultats dans l’apprentissage de la lecture étaient fortement liés à la méthode utilisée. Ce constat n’était pas le but premier de leur étude qui consistait avant tout à valider des outils d’évaluation de la maîtrise de la lecture sur la base d’un échantillon aussi représentatif que possible de la diversité des conditions d’enseignement que l’on rencontre dans une zone géographique limitée tant au point de vue de l’origine sociale des élèves qu’à celui des méthodes d’enseignement de la lecture. Deux tests standardisés ont été proposés en présence de l’enseignant dans le contexte de la classe : une épreuve de décodage (identifier si un mot écrit correspond ou non à l’image qui lui est associée) et une épreuve de compréhension écrite (choisir parmi 4 images celle qui correspond à un énoncé écrit). Les analyses réalisées ont montré que des écoles géographiquement très proches l’une de l’autre – toutes situées dans un rayon de 10 km – enregistraient des rendements très différents en lecture, tant en décodage qu’en compréhension écrite. Contrairement à une opinion fort répandue, cette hétérogénéité n’était pas liée uniquement à des différences de recrutement des élèves, mais aussi à l'inégale qualité de l'enseignement de la lecture dispensé dans les classes. Ainsi, certaines classes accueillant un public socialement et linguistiquement très défavorisé (enfants de migrants issus de milieux modestes et dont la langue parlée à la maison n’est pas le français) obtenaient d’excellents résultats qui pouvaient s’expliquer par le fait que les enseignants utilisaient principalement une « méthode phonique » de l’enseignement de la lecture avec une place importante réservée au décodage (enseignement progressif et systématique des règles de correspondance lettres-sons). À l’inverse, plusieurs classes accueillant des élèves socialement et culturellement privilégiés enregistraient des résultats très médiocres, pour ne pas dire catastrophiques, que l’on pouvait attribuer à une « approche idéovisuelle » de la lecture, centrée presque exclusivement sur des activités de recherche de sens et d’anticipation dans des situations fonctionnelles de lecture, sans enseignement explicite des règles de décodage. De plus, cette inefficacité était associée à une inéquité interpellante : les résultats de l’étude indiquaient que l'approche phonique se caractérise par une moyenne élevée associée à une faible dispersion des résultats alors que l'approche idéovisuelle présente un profil inverse : performances faibles associées à une hétérogénéité élevée. Ces résultats ont depuis lors été confirmés par plusieurs recherches (Ehri, Nunes, Stahl & Willows 2001 ; Goigoux 2000).
Même s’il faut toujours rester prudent dans l’utilisation qui peut être faite des résultats d’une telle recherche, celle-ci est intéressante, notamment parce que les résultats allaient à l’encontre du courant dominant bien pensant (auquel les auteurs de l’étude adhéraient d’ailleurs a priori). La publication de l’étude fut suivie de nombreuses réactions virulentes qui se situaient non pas à un niveau strictement pédagogique ou scientifique, mais aussi et surtout à un niveau politique, et cela de manière paradoxale. En effet, pour une certaine « gauche éthique et pédagogique », selon l’expression de Terrail (2007), il n’était pas question de remettre en question les dogmes du constructivisme et de la pédagogie fonctionnelle. Or, quoi que cette « gauche » puisse en penser, ces approches pédagogiques sont clairement fondées sur un postulat néolibéral : l’élève y est considéré comme le maître de son propre apprentissage, l’école n’ayant qu’à proposer un cadre de travail que l’élève utilisera ou non, comme n’importe quel consommateur. Ce sont, pour reprendre encore l’expression de Terrail, des « pédagogies de l’intelligence et de la liberté ». Les résultats de la plupart des recherches dans ce domaine indiquent que non seulement ces approches constructivistes se révèlent peu efficaces, mais aussi très peu équitables (Bissonnette, Richard, Gauthier & Bouchard 2010 ; Dupriez & Chapelle 2007, Vellas 2008).
5. Conclusion
La première réalité de l’école reste sa complexité : un des plus grands dangers qui guettent ceux qui veulent en analyser le fonctionnement est la dichotomisation. Raisonner en termes de « bons » et de « mauvais » dispositifs pédagogiques conduit toujours à réduire la réalité scolaire et à la caricaturer. Toute analyse qui déboucherait sur l’affirmation que telle ou telle pratique pédagogique promeut ou non le néolibéralisme et devrait dès lors être – de manière exclusive – bannie ou promue nous semblerait suspecte et relativement incohérente.
Par contre, on peut constater que certains dispositifs pédagogiques sont plus ou moins orientés vers une standardisation utilitariste des apprentissages, reposant sur une individualisation non pas du processus d’apprentissage, mais de ses résultats, fondée sur un processus de consommation et, dans une certaine mesure, d’asservissement.
Ces dispositifs peuvent se situer tant en amont du travail scolaire – lorsqu’ils concernent la définition des curriculums, notamment en termes de compétences – qu’en aval de celui-ci – à travers les évaluations des acquis, notamment celles qui sont réalisées à un niveau international – mais aussi dans les pratiques pédagogiques mises en œuvre au sein même de l’école – lorsqu’elles postulent que l’élève est seul maître de son apprentissage et qu’il n’a qu’à se débrouiller tout seul ou avec l’aide de ses proches pour apprendre ce qu’il a à apprendre.
En soi, tous ces dispositifs pédagogiques n’ont rien de répréhensible et ne peuvent être enfermés dans un moule monolithique. Il convient néanmoins de rester critique par rapport à leur mise en œuvre et de se demander à quel type de société ils contribuent, à quelle représentation de l’« être éduqué » ils correspondent.
6. Bibliographie
Ausubel, D. P., 1968, Educational psychology - A cognitive view, New York, Holt, Rinehart & Winston.
Becker, G. S., 1964, 3e éd. 1993, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago, University of Chicago Press.
Berhens, M., 2009, Un laboratoire de formation à petite échelle – Le cas de la Suisse, Communication lors de l’atelier « L’évaluation de l’école par les standards internationaux », au colloque international Un seul monde, une seule école ? Les modèles scolaires à l’épreuve de la mondialisation, Revue internationale d’éducation de Sèvres, Sèvres, CIEP.
Bissonnette, S. & Richard, M., 2001, Comment construire des compétences en classe. Des outils pour la réforme. Montréal, Chenelière/McGraw-Hill.
Bissonnette, S., Richard, M., Gauthier, C. & Bouchard, C., 2010, Quelles sont les stratégies d'enseignement efficace favorisant les apprentissages fondamentaux auprès des élèves en difficulté de niveau élémentaire ? Résultats d'une méga-analyse. Revue de recherche appliquée sur l'apprentissage, 3, article 1, 1-35.
Block, J. H., 1978, The « C » in C B E, Educational Researcher, 7, 13-16.
Bonnard, J., 2013, Pédagogie explicite contre pédagogie de la découverte ? Et si la question était mal posée..., Groupe Français d’Éducation Nouvelle (GFEN), http://www.gfen.asso.fr/fr/pedagogie_explicite_contre_pedagogie_de_la_decouverte_
Bosman, C., Gerard, F.-M., Roegiers, X. (Éds), 2000, Quel avenir pour les compétences ? Bruxelles, De Boeck Université.
Braibant, J.-M. & Gerard, F.-M., 1996, Savoir lire : une question de méthodes ?, Bulletin de psychologie scolaire et d'orientation, 1, 7-45. Disponible sur http://www.skolo.org/spip.php?article128
Carette, V. & Dupriez, V., 2009, La lente émergence d’une politique scolaire en matière d’évaluation des élèves. Quinze ans de transformations en Belgique francophone, Mesure et évaluation en éducation, vol. 32, n°3, 21-45.
Cardinet, J., 1982, Compétences, capacités, indicateurs : quel statut scientifique ?, Actes des Rencontres sur l’Évaluation, CEPEC de Lyon, repris dans Cardinet, J., 1986, Évaluation scolaire et pratique, Bruxelles : De Boeck Université, 129-138.
Carter, S. C., 2000, No Excuses: Lessons from 21 high-performing high-poverty schools, Washington DC, The Heritage Foundation.
Chancerel, J.-L., 2013, Les systèmes éducatifs, les systèmes de formation et le néoliberalisme, Lausanne, Fonds national suisse de la recherche scientifique et Haute école pédagogique du Canton de Vaud.
Crahay, M. 1996, 3e éd. 2007, Peut-on lutter contre l’échec scolaire ?, Bruxelles : De Boeck Université.
Dalymple, T., 2013, Le nouveau syndrome de Vichy [The New Vichy Syndrome : Why European Intellectuals Surrender to Barbarism], Grenoble, Elya Editions.
De Ketele, J.-M., 1996, L’évaluation des acquis scolaires : quoi ? pourquoi ? pour quoi ?, Revue Tunisienne des Sciences de l’Éducation, 23, 17-36.
De Ketele, J.-M., 2010, Faces visibles et cachées des classements internationaux. Une tentative de modélisation des tensions dans l’enseignement obligatoire, Revue internationale d’éducation, n°54, 39-49.
De Ketele, J.-M. & Gerard, F.-M., 2005, La validation des épreuves d’évaluation selon l’approche par les compétences, Mesure et évaluation en éducation, 28(3), 1-26.
Dupriez, V. & Chapelle, G., 2007, Enseigner, Paris, Presses universitaires de France.
Ehri, L. C., Nunes, S. R., Stahl, S. A., & Willows, D. M., 2001, Systematic phonics instruction helps students learn to read: evidence from the national reading panel's meta-analysis. Review of Educational Research, 71(3), 393-447.
Gerard, F.-M., 2001, L’évaluation de la qualité des systèmes de formation, Mesure et Évaluation en Éducation, Vol. 24, n°2-3, 53-77.
Gerard, F.-M., 2013, L’évaluation au service de la régulation des apprentissages : enjeux, nécessités et difficultés, Revue française de linguistique appliquée, XVIII-1, 75-92.
Gerard, F.-M. – BIEF, 2008, 2e éd. 2009, Évaluer des compétences – Guide pratique, Bruxelles, De Boeck.
Gerard, F.-M. & Roegiers, X., 2011, Currículo e Avaliação: ligações que nunca serão suficientemente fortes, in M.P. Alves, & J.-M. De Ketele. (Dir.). Do Currículo à avaliação, da avaliação ao currículo, Porto : Porto Editora, pp. 143-158. Version française disponible sur http://www.bief.be/index.php?enseignement/publications/curriculum_evaluation_des_liens_qui_seront_jamais&s=3&rs=17&uid=479&lg=fr
Goigoux, R., 2000, Apprendre à lire à l’école : les limites d’une approche idéovisuelle, Psychologie française, 45, 233-243.
Houtart, F., 1994, Les effets sociaux des Programmes d'Ajustement Structurel dans les sociétés du Sud, Paris, Centre tricontinental et L’Harmattan.
Jonnaert, P., 2002, Compétences et socioconstructivisme – Un cadre théorique, Bruxelles, De Boeck.
Kahn, S., 2011, Étude des facteurs de réussite et d'échec à l'école, Notes de cours d’étudiants, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, Disponible sur http://dev.ulb.ac.be/bepsy/cms/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1022.
Keeley, B., 2007, Le capital humain : Comment le savoir détermine notre vie, Les essentiels de l’OCDE, Éditions OCDE.
Kirkpatrick, J. D. & Kayser Kirkpatrick, W., 2009, Kirkpatrick Then and Now: A Strong Foundation For the Future, St. Louis, MO, Kirkpatrick Partners.
Laval, C., 2007, Stratégie néolibérale, éducation et connaissance : où en est la recherche ?, Introduction au séminaire 2007-2008, Paris, Institut de recherches de la Fédération syndicale unitaire de l’enseignement, de la recherche et de la culture (FSU).
Letor, C. & Mangez, É., 2008, Tensions autour de la notion de compétence : une pédagogie invisible dans un contexte d’objectivation des résultats, in V. Dupriez, J.-F. Orianne & M. Verhoeven (Éds), De l'école au marché du travail, l'égalité des chances en question, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 333-351.
Ministère de la Communauté française de Belgique, 1999, Socles de compétences – Enseignement fondamental et premier degré de l’Enseignement secondaire.
Roegiers, X., 2000, Une pédagogie de l’intégration. Bruxelles, De Boeck.
Roegiers, X., 2008, L’approche par les compétences dans le monde : entre uniformisation et différenciation, entre équité et inéquité, InDIRECT, n°10, 61-76.
Roegiers, X., 2010, La pédagogie de l’intégration. Des systèmes d’éducation et de formation au cœur de nos sociétés. Bruxelles, De Boeck.
Schultz, T. W., 1961, Investment in Human Capital, American Economic Review, 51, 1-17.
Spady, W.G., 1977, Competency Based Education : A Bandwagon in Search of a Definition, Educational Researcher, 1, 6, 9-14.
Terrail, J.-P., 2007, La syllabique est-elle réactionnaire ?, in G. Krick, J. Reichstadt & J.-P. Terrail, Apprendre à lire – La querelle des méthodes. Paris, Gallimard, 17-46.
Tilman, F., 2008, Les compétences à l’école secondaire, les turbulences d’une réforme, InDIRECT, n°10, 7-29.
Vellas, E., 2008, La mise en œuvre des pédagogies actives et constructivistes, Enjeux pédagogiques, n ?10.
(1) Sur la base de la page de vulgarisation http://www.toupie.org/Dictionnaire/Neoliberalisme.htm, consultée le 17 avril 2014
(2) Les deux premières années du secondaire, soit au total les huit premières années de scolarité obligatoire
(3) Towards a theory of educational transmission, Class, code and control (1977) et Class, codes and control (1990)
(4) TIMSS : Trends in International Mathematics and Science Study, International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) ; PISA : Programme international pour le suivi des acquis des élèves, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ; PIRLS : Programme international de recherche en lecture scolaire ; MLA : Modern Language Association.
(5) Les évaluations PISA se veulent en réalité indépendantes des curriculums. Elles ont pour objectif principal de vérifier que des jeunes qui quitteraient le système scolaire disposent de toutes les ressources nécessaires pour se retrouver dans la « vraie vie ».
(6) Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire, en application de l'art. 62, al. 4, de la Constitution fédérale.
(7) Jusqu’à 2009, il n’existait en Communauté française de Belgique aucune épreuve d’évaluation certificative externe, la décision de certification dépendant des équipes éducatives locales. Depuis cette date, le CEB est obligatoire pour toutes les écoles. Il existe deux autres épreuves externes certificatives : le CE1D, pour les élèves de fin de deuxième année du secondaire, obligatoire depuis 2013, et le TESS, pour les élèves de fin du secondaire – équivalent au Bac français – obligatoire à partir de 2015.

Textes






